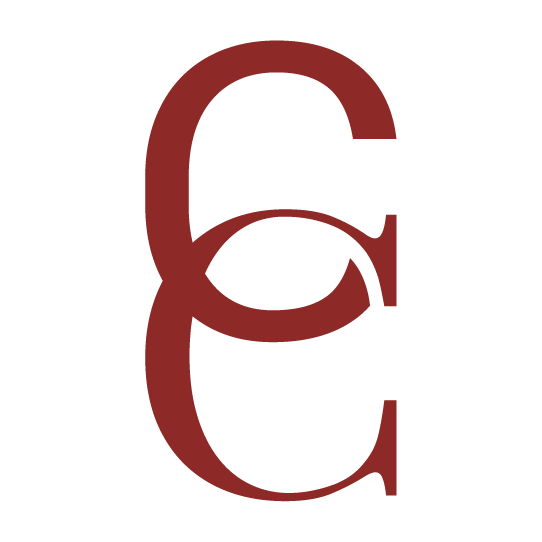Pour une carte d’identité numérique capable d’authentifier les contenus à l’ère de l’IA générative
La généralisation des outils d’intelligence artificielle générative bouleverse notre rapport à l’image. Les deepfakes ne sont plus des curiosités techniques : ils deviennent des instruments d’influence, de manipulation et parfois de désinformation. Une voix, un visage, un geste peuvent désormais être reproduits à la perfection, jusqu’à rendre la falsification indétectable à l’œil humain.
Dans ce contexte, la question de la confiance numérique devient centrale. Comment distinguer une image authentique d’un contenu synthétique ? Comment prouver qu’une vidéo a bien été produite par la personne qu’elle représente ?
Aujourd’hui, la réponse n’existe pas vraiment. Pourtant, la solution pourrait bien être déjà à portée de main : appliquer aux contenus visuels le même principe que celui de la signature électronique.
Une idée simple : signer les images et vidéos à la source
Chaque citoyen pourrait disposer d’une paire de clés asymétriques :
• une clé privée, stockée de manière sécurisée sur ses appareils personnels,
• une clé publique, inscrite dans un registre officiel.
Lorsqu’une photo est prise ou qu’une vidéo est enregistrée, l’appareil calcule automatiquement une empreinte numérique (un hash) du fichier et la chiffre avec la clé privée du propriétaire. Cette opération constitue la signature du contenu.
Toute personne souhaitant vérifier l’authenticité d’une image pourrait alors comparer cette signature à la clé publique correspondante, disponible via le registre. Si les deux concordent, le fichier est authentique et non modifié. Si la signature est absente ou invalide, le contenu peut être considéré comme non vérifié — voire potentiellement falsifié.
Ainsi, une image produite par un outil d’intelligence artificielle ne pourrait pas être « signée » sans posséder la clé privée de l’auteur.
L’État comme tiers de confiance
Une telle infrastructure ne peut reposer sur le secteur privé seul. Elle nécessite la mise en place d’une autorité publique de certification, comparable à un service d’état civil numérique.
L’État délivrerait à chaque citoyen une carte d’identité numérique comportant :
• la paire de clés (publique et privée),
• un mécanisme de révocation en cas de perte, vol ou usurpation,
• un accès vérifiable aux clés publiques via une interface ouverte.
De la même manière qu’un passeport prouve une identité dans le monde physique, cette carte d’identité numérique garantirait l’authenticité des contenus produits dans le monde numérique.
Cette approche permettrait également d’encadrer l’usage de l’image d’autrui : un contenu mettant en scène une personne sans signature correspondante pourrait être signalé, voire bloqué, selon le cadre légal défini.
Une perspective européenne : souveraineté et interopérabilité
Ce modèle s’inscrit naturellement dans la continuité du règlement eIDAS 2.0, qui prévoit la création d’un portefeuille européen d’identité numérique (EUDI Wallet). Ce dispositif vise déjà à permettre à tout citoyen de prouver son identité ou de signer des documents électroniques de manière souveraine et interopérable.
Étendre ce principe à la production d’images et de vidéos serait une évolution logique.
Un standard européen d’authentification des contenus pourrait :
• imposer que les appareils photo, smartphones et logiciels de traitement intègrent la signature à la création,
• garantir la compatibilité des signatures entre États membres,
• renforcer la confiance dans les médias et la communication publique.
Les défis à anticiper
Une telle infrastructure pose évidemment plusieurs questions techniques et éthiques :
• Protection de la clé privée : elle devrait rester strictement personnelle et stockée localement, à l’abri des accès extérieurs.
• Interopérabilité des systèmes nationaux : comment assurer une vérification fluide entre pays et plateformes ?
• Vie privée et consentement : comment éviter qu’un mécanisme d’authentification ne devienne un outil de traçage ?
• Adoption industrielle : comment convaincre fabricants, éditeurs et réseaux sociaux d’adopter le standard ?
Ces défis sont réels, mais ils ne doivent pas masquer l’enjeu principal : l’absence d’authentification affaiblit la confiance collective. Sans un socle technique et institutionnel de vérification, la distinction entre réel et simulé deviendra impossible à maintenir.
Vers un Internet de la preuve et de la responsabilité
Signer une image ou une vidéo, ce n’est pas seulement prouver qu’elle est vraie. C’est aussi assumer sa responsabilité d’auteur.
Dans un monde saturé de contenus générés par des intelligences artificielles, la signature numérique pourrait redevenir l’équivalent moderne de la signature manuscrite : une marque de confiance, de transparence et d’éthique.
L’enjeu dépasse la technique. Il s’agit d’une vision politique du numérique, fondée sur la souveraineté, la traçabilité et la responsabilité individuelle.
Parce qu’à terme, ce n’est pas seulement l’image que nous devons protéger — c’est la vérité elle-même.
- Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können