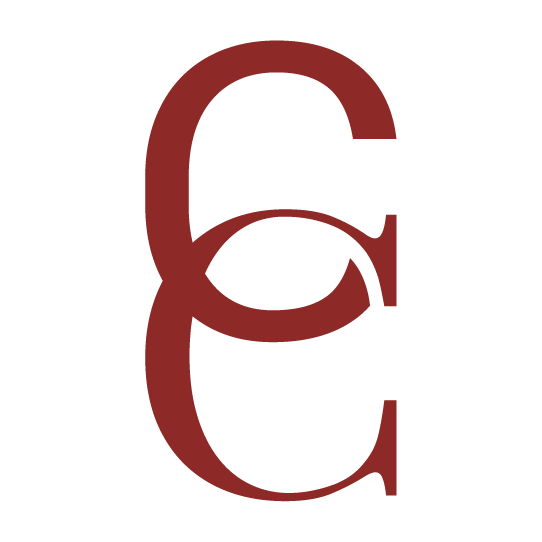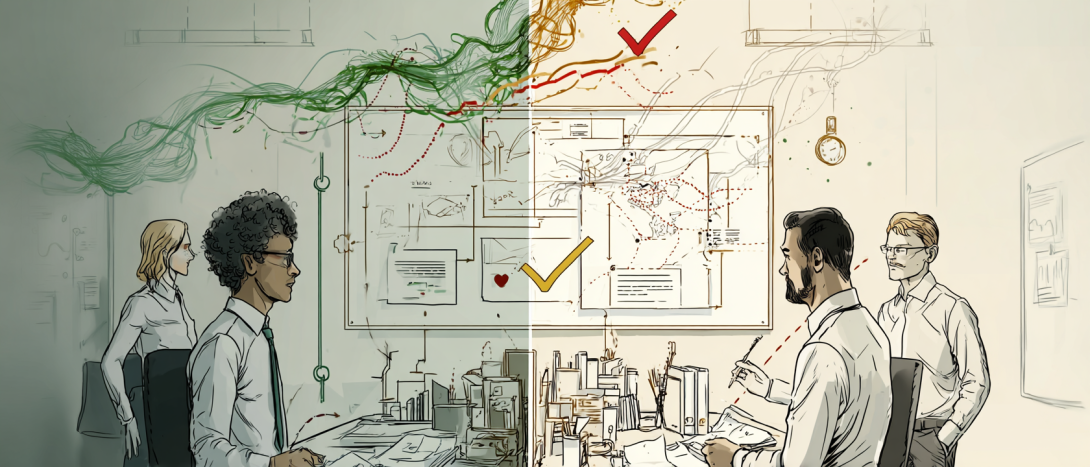
L’automatisation : promesse d’efficacité ou mirage technologique ?
Depuis plusieurs années, l’automatisation fait partie des priorités stratégiques des directions générales. Les assureurs, les courtiers et les acteurs de la cybersécurité n’y échappent pas. La promesse est séduisante. Réduire les tâches répétitives, accélérer les flux de traitement, diminuer les erreurs humaines, réallouer des équipes entières vers des missions à plus forte valeur. Tout semble indiquer que l’entreprise du futur sera orchestrée par une symphonie de robots logiciels et d’agents intelligents.
Pourtant, le sujet mérite d’être abordé avec nuance. L’automatisation ne remplace pas l’humain. Elle déplace simplement la frontière entre ce que les machines font bien, ce qu’elles font mieux et ce qu’elles ne pourront probablement jamais faire. Dans les métiers du risque, cette frontière est particulièrement sensible.
McKinsey estimait dès 2017 que 60 % des métiers pourraient voir au moins 30 % de leurs tâches automatisées, mais que moins de 5 % des métiers étaient automatisables entièrement (McKinsey Global Institute, “A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity”). Une tendance confirmée par l’OCDE qui parle d’un glissement progressif des compétences vers l’analyse, le jugement, la relation humaine.
Autrement dit, le cœur du métier reste profondément humain. L’automatisation est un outil, pas une stratégie.
Ce qui peut être automatisé : la mécanique invisible mais indispensable
Les tâches run, celles qui gardent l’entreprise en mouvement au quotidien, sont les candidates naturelles à l’automatisation. Elles reposent sur des règles connues, peu de nuances et une forte répétitivité. C’est le domaine où les machines excellent, et où l’humain n’apporte qu’une valeur marginale. Un système peut suivre l’avancement d’un dossier, générer automatiquement un compte rendu d’intervention à partir d’événements horodatés, relancer un client en retard de paiement, ou déclencher la facturation à l’issue d’une prestation. Dans ces cas-là, automatiser améliore la fluidité, réduit les oublis et augmente la qualité du service sans dénaturer le métier.
Les entreprises qui opèrent dans la cybersécurité, l’assurance ou le conseil tech y trouvent un avantage évident : un pilotage opérationnel plus fiable, plus régulier et moins dépendant du facteur humain, avec une capacité de montée en charge facilitée. La machine ne s’improvise pas analyste, mais elle s’avère imbattable pour tenir un suivi conforme et minutieux.
Ce qui ne peut pas être automatisé : la valeur humaine au cœur du risque
À l’opposé, les tâches build relèvent de la réflexion, du jugement et de l’expérience. Elles ne se prêtent pas à l’automatisation, car elles supposent une compréhension globale d’un contexte, une analyse fine des enjeux et une capacité à arbitrer en situation d’incertitude. Aucun système ne peut, aujourd’hui, décortiquer un document stratégique complexe, identifier les signaux faibles d’un contrat mal ficelé, négocier des objectifs contradictoires ou décider de la bonne orientation d’un comité de pilotage.
Définir une stratégie, analyser un rapport d’incident, comprendre les subtilités d’une architecture sensible ou synthétiser un ensemble d’informations ambiguës restent des tâches fondamentalement humaines. Ce sont précisément ces missions qui constituent la valeur du métier, car elles mobilisent ce que la machine ne possède pas : la compréhension tacite, l’expérience vécue, la lecture émotionnelle des situations.
L’automatisation retire de l’effort là où l’humain n’était pas indispensable. Elle ne remplace jamais la responsabilité là où l’humain est essentiel.
« L’automatisation n’est pas un substitut à l’expertise. C’est un amplificateur de discernement, à condition que l’humain reste aux commandes. »
Les risques : quand l’automatisation fabrique des angles morts
Toute automatisation introduit une part nouvelle de fragilité. Ce paradoxe est bien documenté : plus un système gagne en efficacité, plus il devient dépendant de ses propres automatismes. L’histoire du Boeing 737 MAX et du MCAS en est l’exemple le plus éclairant, même s’il ne s’agit pas d’une entreprise classique, mais d’un système critique où l’automatisation mal comprise a entraîné des dérives dramatiques (Rapport du National Transportation Safety Board, 2019).
Les entreprises ne sont pas à l’abri du même phénomène à une échelle différente. Une automatisation mal configurée, mal surveillée ou mal comprise peut provoquer des erreurs en chaîne, renforcer des biais dans les données, appliquer des règles hors contexte ou laisser passer des signaux faibles cruciaux. Les systèmes automatisés sont rapides, mais rarement tolérants à l’ambiguïté.
Dans les métiers de la gestion du risque, l’erreur automatique n’est pas une simple erreur. Elle est exponentielle.
Responsabilités : qui répond quand la machine se trompe ?
La question juridique devient centrale. Les entreprises sont confrontées à un paradoxe : elles automatisent pour réduire le risque humain, mais se retrouvent confrontées à un risque algorithmique qu’elles doivent encore apprendre à maîtriser.
La CNIL rappelle dans plusieurs rapports que les organisations restent pleinement responsables des décisions produites par leurs systèmes automatisés, notamment lorsqu’ils interviennent dans des processus sensibles ou impactant la vie des individus (CNIL, “L’IA : comment permettre à l’homme de garder la main ?”, 2017).
Dans le domaine assurantiel ou cyber, cela implique une exigence accrue : audit régulier des workflows automatisés, documentation fine des modèles utilisés, surveillance continue des dérives, traçabilité des décisions, capacité d’interrompre un processus défaillant. Automatiser oblige à une hygiène technique irréprochable.
La responsabilité ne se délègue pas à un algorithme.
Vers une automatisation responsable : le futur appartient aux entreprises qui savent arbitrer
L’automatisation n’est pas une révolution technologique. C’est une révolution de discernement. La vraie compétence stratégique consiste à décider ce qui doit être automatisé, ce qui doit être assisté et ce qui doit absolument rester entre des mains humaines.
Les entreprises qui réussiront ne seront pas celles qui automatisent le plus, mais celles qui automatisent le mieux.
Celles qui utilisent la technologie pour renforcer le métier, pas pour l’éroder.
Celles qui consacrent l’humain aux décisions critiques et la machine au reste.
Celles qui comprennent que l’automatisation n’est pas une fuite en avant, mais un instrument de précision.
Et, surtout, celles qui acceptent que la responsabilité ne se programme pas.